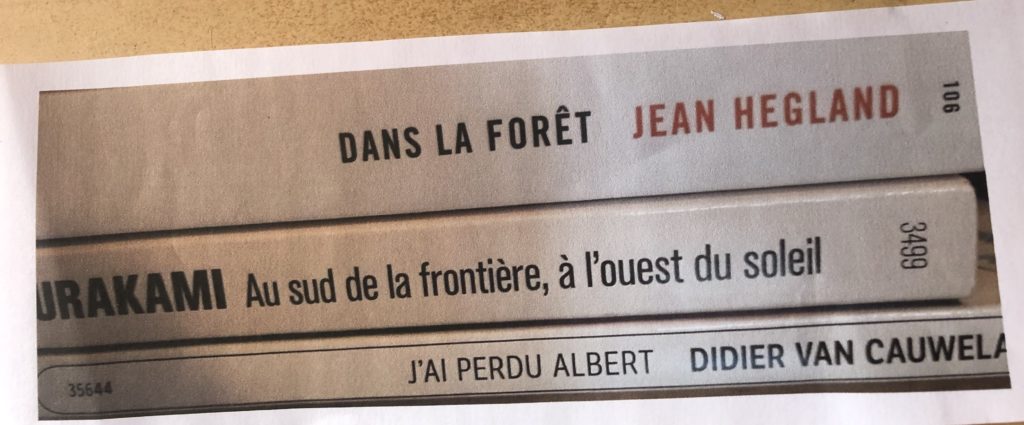Pour cette première publication depuis de longs mois… (j’espère pouvoir reprendre à un rythme plus soutenu, l’envie d’écrire revient tout doucement), je vous fais partager le texte que j’ai écrit à l’occasion de la performance d’écriture annuelle organisée par l’Alliance française de Genève, et qui s’est déroulée ce samedi soir. À partir de 3 « inspirations », nous avions 3 heures pour écrire un texte d’une page maximum. Les textes sélectionnés par un jury seront publiés sur le site de l’Alliance française dans quelques semaines.
Voici le mien.
Moi, Camille, j’ai toujours été une fille, quoi qu’en dise ma carte d’identité, l’appendice pendant entre mes jambes, la couleur bleue de mes bodys, celle du papier peint de ma chambre, du bleu tout autour de moi, comme pour enfoncer le clou, du bleu partout
Moi, Camille, j’ai toujours été à ma place en compagnie des femmes, ma mère, ma grand-mère, mes tantes, mes cousines, toutes celles que je considérais comme mes semblables sans pouvoir l’exprimer
Moi, Camille, on a bien essayé de me transformer en parfait petit gars, de me modeler en fonction des passions jugées normales pour quelqu’un de mon sexe, j’ai eu mon lot de camions de pompier, des déguisements de policier, avec matraque incluse, de stages de football, de karaté
Moi, Camille, je regardais en rêvant mes camarades jouant à la marelle ou faisant la démonstration de leurs jupes de princesse qui tournoyaient
Moi, Camille, j’aurais tant aimé avoir aussi des robes qui tournaient et de jolies sandales, mais ce n’était pas correct, et arrête de voler les vêtements de maman, Camille, tu es ridicule, c’est pas mardi gras
Moi, Camille, je ne volais rien, pourtant, je ne jouais aucun rôle, sauf quand je me forçais à sourire quand on vantait ma musculature, quand on me comparait avec mon père
Moi, Camille, j’aurais aimé être aussi jolie que maman, j’aurais aimé qu’on me complimente pour mes beaux cheveux, toujours coupés trop courts même quand je faisais des caprices chez le coiffeur, même quand j’éclatais en sanglots en voyant les longues mèches s’écrouler au sol
Moi, Camille, j’ai voulu mourir quand mon corps s’est transformé, que ma voix a mué, que d’horribles poils sont venus encombrer le tour de ma bouche. Être un garçon, je pouvais presque le supporter, mais être un homme, jamais. Ce jour-là, mon père m’a proposé fièrement de me prêter son rasoir, et j’ai eu peur de ce que j’en ferais si j’acceptais, alors j’ai fui. Ce jour-là, j’ai couru jusqu’à ce que mes poumons me brûlent, jusque dans la rue où j’ai failli renverser une vieille dame penchée sur ses sacs de course. Surprise, elle s’est exclamée : « Où cours-tu comme ça, jeune fille ? ». Je l’aurais embrassée. Elle ne saura jamais à quel point elle m’a sauvée.
Moi, Camille, j’ai 19 ans aujourd’hui et je sors de la sous-préfecture. Je retourne ma nouvelle carte d’identité dans mes mains, j’ai encore un peu de mal à le croire. Je lis et relis les informations. Camille Lambert, nationalité française, née le 10 juin 2002. Sexe : féminin.
Moi, Camille, je suis enfin celle que j’ai toujours été.